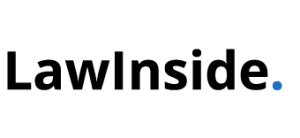L’absence de base légale pour une compensation financière en plus de celle accordée par la CourEDH en cas de détention injustifiée
Il manque, en droit national, une base légale pour l’octroi d’une compensation financière en raison d’une détention injustifiée, lorsque la CourEDH a déjà accordé une telle compensation.
Faits
En novembre 2009, le procureur général zurichois saisit l’Obergericht pour demander l’internement ultérieur d’un prisonnier condamné à 20 ans de peine privative de liberté dans les années 1990, sur la base de l’art. 65 al. 2 CP. La peine privative de liberté prend fin le 8 octobre 2010, à la suite de quoi l’intéressé est placé en détention pour motifs de sûreté.
Après plusieurs renvois d’affaire, dont un passage par-devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B_404/2011 du 2 mars 2012), le Bezirkgsericht ordonne l’internement sur la base de l’art. 65 al. 2 CP en relation avec l’art. 64 al. 1 lit. b CP. L’affaire est à nouveau portée jusqu’au Tribunal fédéral, qui rejette le recours en matière pénale formé par l’intéressé (arrêt 6B_896/2014 du 16 décembre 2015).
Saisie à son tour, la CourEDH constate une violation des art. 5 ch. 1 CEDH, 7 ch. 1 CEDH et de l’art. 4 du 7e Protocole additionnel (arrêt W.… Lire la suite